Dossier Laméca
Fonds romans Laméca
un guide de lecture en 16 auteurs caribéens
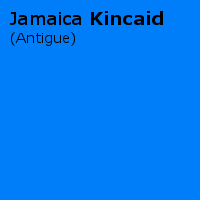
« Nous étions assises sur deux chaises, sans nous faire face, parlant sans mots, échangeant des pensées. Elle me parlait de sa vie, de l’époque où elle allait nager. »
Autobiographie de ma mère, p. 77
Présentation de l’auteure
La limpidité du style des récits ayant pour ancrage Antigue et pour entourage, la famille et le voisinage, a révélé Elaine Potter Richardson, plus connue sous le nom de plume Jamaica Kincaid. D’une mère dominiquaise et d’un père antiguais, la romancière a vu le jour dans la ville de Saint-John à Antigue en mai 1949. Initialement envoyée pour raisons économiques aux Etats-Unis à l’âge de 16 ans, elle s’y est établie depuis lors. S’illustrant en premier lieu en tant que rédactrice pour le magazine New Yorker, elle publie par la suite une douzaine d’œuvres dont des nouvelles et des romans ainsi que plusieurs essais.
Présentation de l’œuvre
Une autobiographie fictionnelle, tel est le qualificatif qui pourrait convenir à la production de Jamaica Kincaid tant l’univers de fiction s’entremêle avec des pans entiers de son existence à Antigue. Imprégnée de sentiments antagonistes - mélange d’amour, désamour, colère et nostalgie -, l’auteure n’en demeure pas moins attachée à son pays natal. Son style épuré, éruptif et perçant lui a valu des distinctions pour ces romans Autobiographie de ma mère, Annie John ou Mon frère, mais aussi le courroux des autorités locales qui ont notamment censuré son livre A Small place. Dans nombre de ses romans, l’écrivaine dénonce ouvertement les injustices, les inégalités, la pauvreté sévissant à Antigue, elle pointe du doigt les pouvoirs en place, responsables selon elle, de la régression économique et sociale de l’île.
Aînée d’une famille de 4 enfants, l’auteure a entretenu dans sa tendre enfance une relation fusionnelle avec sa mère qui se délitera rapidement dès l’adolescence. Ces relations complexes familiales seront largement explorées dans ses récits et romans avec notamment les personnages de jeunes filles en proie à un large éventail de sentiments et comportements imprévisibles : fougue, colère, impertinence, etc.
La fiction biographique : un art d’écrire
Ce n’est pas par hasard que l’auteure publie sous le nom de plume Jamaica Kincaid, qui rappelle ses origines caribéennes. Souvent empreints de tonalités psychanalytiques, ses récits et romans introspectifs donnent l’impression que l’auteure assainit les relations jadis tendues, avec son entourage, et plus encore avec elle-même. En guise de procédés narratifs, la voix d’une jeune fille tantôt narratrice, tantôt protagoniste dans Lucy, Mon frère, Autobiographie de ma mère, se superpose à celle de l’auteure, de sorte que les énonciatrices dominantes alternent au gré des fonctions qui leur sont attribués dans le cadre de discours, événements, souvenirs ; d’argumentations ; ou de dialogues. Ce parti pris pour la fiction autobiographique a donné lieu à un malentendu durable notamment en termes de réception de l’œuvre de l’auteure. En effet, une partie de la critique journalistique s’est cantonnée bien souvent à lire les œuvres de Kincaid à l’aune de la vie de l’auteure, comme si ces écrits devaient uniquement refléter et satisfaire leurs attentes. Ainsi, l’auteure a eu l’occasion d’expliquer à plusieurs reprises (1) qu’elle se sentait incomprise, sommée de se justifier et défendre le dosage de fiction dans la trame, le portrait des personnages ou les dialogues. L’exemple de son roman See now then est à ce titre évocateur, puisque des questions se rapportant à sa vie privée lui ont été posées par la critique dans le but d’établir le degré d’auto-fiction contenu dans ses romans.
Antigue : une île peu connue
Si ce n’est par le biais de Jamaica Kincaid, ambassadrice malgré elle, peu de lecteurs auraient découvert certaines facettes de l'île d’Antigue. Aux antipodes d’une évasion touristique, ce sont les réalités contrastées de la vie sur l’île qui sont dépeintes par l’auteure laquelle n’hésite pas à critiquer les décideurs politiques, le néocolonialisme, l’attentisme des Antiguais et autres tares qui découlent selon elle, d’un héritage lourd. Ce n’est qu’en 1981 que Antigue, dont le niveau de vie est plutôt faible, accède à l’indépendance de la couronne britannique. Faisant écho à cette pauvreté, l’auteure décrit dans son roman Mon frère, l’extrême précarité du secteur de santé, et le dénuement des hôpitaux comparés au système américain. Elle y raconte comment son frère drogué, est mort à 33 ans du sida dans un pays résigné à mener le combat contre cette maladie. Un passage sur sa prise en charge est particulièrement édifiant :
« Les médicaments couramment utilisés dans le traitement des maladies liées au sida ne sont pas disponibles à l’hôpital, les gens qui ne sont pas affectés du virus qui cause le sida ne souffrent pas de muguet aigu, n’attrapent pas de terribles pneumonies, et les médicaments qui permettent de traiter ces affections ne sont donc pas disponibles à l’hôpital. Mais pourtant ceci : une nuit mon frère eut une terrible migraine et il lui fallut quelque chose pour calmer la douleur ; il n’y avait pas d’aspirine à la pharmacie. Une infirmière qui était de service en avait dans son sac pour son usage personnel et elle en donna deux comprimés à mon frère. Il y a des gens qui se plaignent qu’un hôpital, aux Etats-Unis factures six dollars une dose de Tylenol ; ils voudront peut-être considérer cette façon de gérer un hôpital : apportez vos propres médicaments. » (Mon frère, p. 38)
Parce qu’elle a toujours dénoncé ce type d’injustices découlant pour beaucoup des conséquences de la colonisation, puis de piètres gouvernances selon l’auteure, Kincaid a de longues années durant, été bannie de son pays, ne pouvant retourner dans son île natale qu’en 1992. Ces critiques virulentes trouvent un écho de grande ampleur dans le roman A Small place (1988), qui lui ont valu autant d’applaudissements que d’attaques acerbes.
Mots clés
Antigue • Etats-Unis • Exil • Colonialisme • Empire Britannique • Autobiographie • Autofiction • Pamphlet • Censure • Politique • Dénonciation • Enfance • Mythe • Famille
Bibliographie sélective
- Annie John, 1986, Paris, Olivier, 1996 (traduction française).
- A Small Place, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1988.
- Lucy, New York, Farrar, Straus & Giroux 1990.
- Au fond de la rivière, 1992, Paris, Olivier, 2001 (traduction française).
- The Autobiography of My Mother, New York, Plume/Penguin, 1997.
- Mon frère, 1997, Paris, Seuil, 2001(traduction française).
- See now then, New York, Farrar, Straus & Giroux, 2013.
Pour aller plus loin
Extraits

Je me levai au bord du bassin et me sentis bouger. Mais qui étais-je ? Car je n’avais pas de pieds, ou de mains, ou de tête, ou de cœur. C’était comme si ces choses — mes mains, ma tête, mon cœur —, qui avaient été là, m’étaient maintenant ôtées, comme j’avais plongée et replongée, encore et encore, dans une grande cuve pleine de certains éléments précieux et étais désormais réduite à une chose pour laquelle je n’avais pas encore de nom. Je n’avais pas de nom pour la chose que j’étais devenue, tant elle était neuve pour moi, excepté le fait que je n’existais ni dans la peine ou le plaisir, ni à l’est ou à l’ouest ou au nord ou au sud, ou en haut ou en bas, ou dans le passé, le présent ou le futur, ou dans le réel ou l’irréel. Je me dressai comme si j’étais un prisme, aux faces nombreuses et transparentes, réfractant et reflétant la lumière quand elle m’atteignait, une lumière qui jamais ne pourrait être détruite. Et comme je devins belle.
Au fond de la rivière, p. 94
L’Antigue, que j’ai connue, l’Antigue dans laquelle j’ai grandi, n’est pas l’Antigue que vous, touriste, verriez aujourd’hui. Cette Antigue n’existe plus. Cette Antigue n’existe plus en partie pour la raison habituelle, le passage du temps, et en partie parce que les gens malintentionnés qui y réglaient naguère, les Anglais ont cessé de le faire.
Au fond de la rivière, p. 120

Un jour où la rivière était très grosse et où nous la traversions nus, nous avons vu une femme à l’embouchure. Elle était profondément enfoncée dans l’eau et nous ne pouvions dire si elle était assise ou debout, mais nous savions qu’elle était nue. C’était une très belle femme, plus belle que toutes les femmes que nous avions jamais vues, belle d’une façon que nous comprenions, pas à l’européenne : elle avait la peau brun foncé, ses cheveux noirs brillants entouraient son visage de petites boucles. Elle avait un visage comme la lune, une lune douce, brune, lumineuse. Elle a ouvert la bouche et un son étrange mais agréable en est sorti. C’était fascinant ; nous sommes restés à la regarder. Elle était entourée de fruits, des mangues — c’était la saison — bien mûres, dans ces harmonies de rouge, de rose et de jaune qui les rendent si tentantes et appétissantes. Elle nous a fait signe d’approcher. Quelqu’un a dit que ce n’était pas une vraie femme, que nous devrions partir, que nous devrions nous enfuir. Nous ne pouvions bouger. Et puis un garçon — je me souviens de son visage parce qu’il était le masque mâle de l’insouciance et de la vantardise que j’ai appris à reconnaître¬ — s’est avancé, s’est avancé encore ; il riait en avançant. Quand il semblait atteindre l’endroit où se trouvait la femme, elle s’éloignait, et pourtant elle était toujours au même endroit. Il s’est mis à nager vers elle et les fruits, et chaque fois qu’il approchait, elle s’éloignait. Il a nagé de cette façon jusqu’à ce qu’il commence à couler d’épuisement ; on ne voyait plus que le haut de sa tête, que ses mains ; puis on n’a plus rien vu, juste des cercles concentriques qui s’élargissaient là où il était, comme quand on jette un caillou. La femme et ses fruits avaient disparu aussi, comme si elle n’avait jamais été là, comme si tout ce n’était jamais arrivé. L’enfant a disparu ; on ne l’a jamais revu, même pas mort, et quand les eaux ont baissé à cet endroit, nous sommes allés regarder, mais il n’était pas là.
Autobiographie de ma mère, p. 40

Le sentiment général me dit-on, est que puisqu’il n’existe pas de remède capable guérir du sida, il est inutile de dépenser de l’argent pour un médicament qui ne fait que ralentir les progrès de la maladie ; ceux qui en sont atteints mourront quoi qu’il arrive, les ressources disponibles pour les dépenses de santé sont limitées et mieux vaut les consacrer à ce qui fera du bien plutôt qu’à un domaine où l’on sait que le résultat sera la mort.
Mon frère, p. 36
Les médicaments couramment utilisés dans le traitement des maladies liées au sida ne sont pas disponibles à l’hôpital, les gens qui ne sont pas affectés du virus qui cause le sida ne souffrent pas de muguet aigu, n’attrapent pas de terribles pneumonies, et les médicaments qui permettent de traiter ces affections ne sont donc pas disponibles à l’hôpital. Mais pourtant ceci : une nuit mon frère eut une terrible migraine et il lui fallut quelque chose pour calmer la douleur ; il n’y avait pas d’aspirine à la pharmacie. Une infirmière qui était de service en avait dans son sac pour son usage personnel et elle en donna deux comprimés à mon frère. Il y a des gens qui se plaignent qu’un hôpital, aux Etats-Unis factures six dollars une dose de Tylenol ; ils voudront peut-être considérer cette façon de gérer un hôpital : apportez vos propres médicaments.
Mon frère, p. 38
Un jour voilà des années - j’avais trente-six ans, il en avait vingt-trois - j’étais en visite dans ma famille, j’étais étendue sur le lit de mon frère dans sa petite maison, mes pieds reposant sur l’appui de la fenêtre et au soleil. J’avais accoutumé de faire exactement cela quand j’étais enfant : m’étendre sur le lit les pieds reposant sur l’appui de la fenêtre et au soleil, parce que j’avais toujours froid aux pieds, à l’époque. Je lisais à l’époque, et ce tableau entier, moi étendue au lit à lire des livres, causait à ma mère des accès de colère car elle était sûre qu’il signifiait que j’étais condamnée à écrire des livres que d’autres gens liraient peut-être. A ce moment où j’étais étendue sur le lit de mon frère, il était assis sur le seuil de sa porte. D’ordinaire, il était étendu sur son lit. Il avait l’habitude de s’étendre sur son lit dans un état d’hébétude induit par la drogue. Sa mère ne l’aurait pas autorisé à faire cela s’il avait été une femme, je le sais.
Mon frère, p. 47
Je suis restée longtemps à le regarder avant qu’il se rende compte que j’étais là. Et puis quand il s’en est rendu compte, il a soudain rejeté le drap, arraché son pantalon de pyjama de sa taille, révélant son pénis, et puis il a saisi son pénis à la main et l’a brandi, et son pénis avait l’air d’une fleur meurtrie qu’on avait coupée court sur sa tige, il était couvert de plaies et sur les plaies il y avait une substance blanche, presque crémeuse, presque farineuse, un champignon. Quand il saisit son pénis à la main, il l’a soudain dirigé vers moi, comme pour me le mettre sous le nez, et il a dit d’une voix qui était pleine d’une profonde panique et d’une profonde frayeur, « Jamaica, regarde-moi ça, mais regarde-moi ça. » Tout dans ce geste-là était déconcertant ; que faire, que dire ; voir le pénis d’homme adulte de mon frère, et voir son pénis avec cet aspect-là, le voir, lui, devenu incapable de comprendre que peut-être, il n’aurait tout simplement pas dû me montrer à moi - sa sœur - son pénis, sans m’avoir préparé à voir son pénis. Je ne voulais pas voir son pénis ; à ce moment-là, je ne voulais voir aucun pénis quel qu’il fût.
Mon frère, p. 90
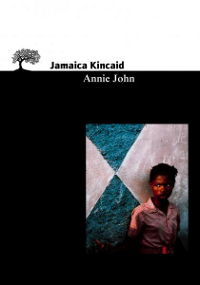
Le professeur de piano raconta mes larcins à maman qui se détourna de moi d’une façon telle que si je lui avais demandé qui j’étais, elle aurait sans doute répondu tout net : « Je ne sais pas. » Quel choc ! Ma mère se détournait de moi avec dégoût.
A vrai dire, je ne passais pas tout mon temps collé à maman, avant ces histoires de « demoiselle ». Il y avait les heures de classe. Mais je pouvais du moins rester assise et penser à elle, je pouvais la regarder passer d’une activité à l’autre, et elle me réservait toujours un sourire. Désormais, les coins de sa bouche retombaient souvent en une moue de désapprobation.
Annie John, p. 36
Maman savait comme moi que si elle me disait quelque chose dans mon comportement lui rappelait ce qu’elle était à mon âge, je m’efforçais de changer d’attitude, m’ingéniant à agir d’une façon qui lui soit intolérable. Par ruse, elle couvrait de louanges ce qui n’était chez moi que dissimulation. Je devins en effet cachottière et maman dut m’avertir que j’étais sur la mauvaise pente, que seuls les menteurs et les voleurs avaient des secrets. Bientôt, ma mère et moi, nous avions adopté deux visages : l’un pour mon père et le reste du monde, l’autre pour nous lorsque nous nous trouvions seules face à face. Pour les autres, nous n’étions que politesse, gentillesse, amour, rires. Je la voyais avec ses yeux d’autrefois. Elle redevenait la mère qui me frottait le dos, qui examinait chaque partie de mon corps pour s’assurer que rien d’anormal n’y apparaissait. La mère qui préparait mon dessert préféré, un blanc-manger, pour me récompenser d’une réussite dans un domaine qu’elle approuvait. La mère qui s’inquiétait pour ma santé si je reniflais et, par précaution, appliquait aussitôt un cataplasme au camphre et à l’eucalyptus. En moi j’écoutais le chantonnement de sa voix attentionnée, aimante, apaisante, et je jouais avec ses cheveux tandis qu’elle défaisait ses nattes pour le brossage quotidien. J’enfouissais mon visage dans cette somptueuse chevelure noire et respirais profondément son parfum d’essence de rose.
Annie John, p. 99
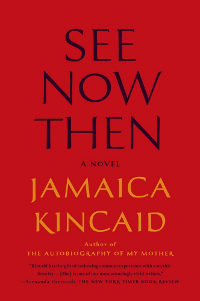
All that was visible to Mrs. Sweet as she stood in the window, but so much was not visible to her then, it lay before her, all clear and still, as if trapped on a canvas, enclosed in a rectangle made up of dead branches of Betula nigra, and she could not see it and could not understand it even if she could see it: her husband, the dear Mr. Sweet, hated her very much. He so often wished her dead (…)
See now then, p. 6
_________________________________
(1) Article de Felicia Lee, “Never Mind the Parallels, Don’t Read It as My Life”, New York Times, 4 février 2013 (http://www.nytimes.com/2013/02/05/books/jamaica-kincaid-isnt-writing-about-her-life-she-says.html)
______________________________________
SOMMAIRE
 ______________________________________
______________________________________
par Dr Ayelevi Novivor
© Médiathèque Caraïbe / Conseil Départemental de la Guadeloupe, 2017-2018

